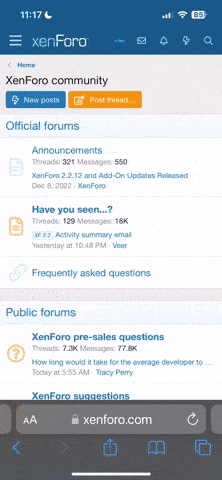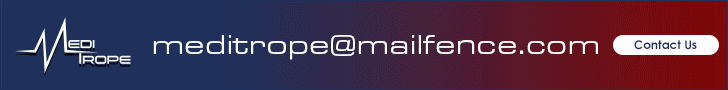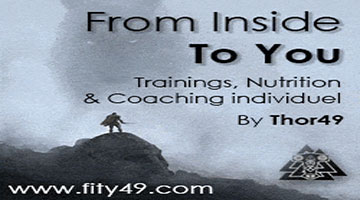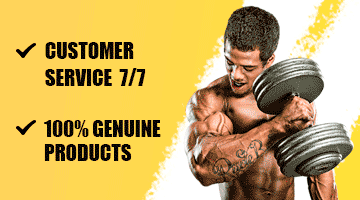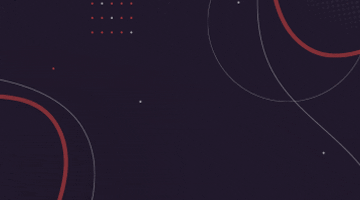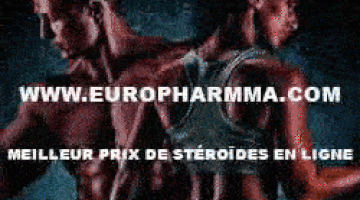Information presse
Progéria : résultats prometteurs d’une nouvelle thérapie génique chez
l’animal
Depuis quelques années, la recherche scientifique autour de la Progéria, maladie qui
entraine un vieillissement prématuré des enfants, avance à grand pas. En 2003 le gène a
été découvert par l’équipe de Nicolas Lévy et en 2008 douze enfants ont pu entrer dans un
essai clinique combinant deux molécules dans le but de ralentir les effets du
vieillissement précoce caractéristique de la maladie. Toutefois, les chercheurs
poursuivent leurs efforts, pour, cette fois-ci, tenter de corriger les conséquences du
défaut génétique à l’origine de la Progéria. Jusqu’alors aucun modèle mimant exactement
les effets de la maladie chez l’homme n’existait. Les travaux menés en étroite
collaboration depuis plusieurs années par l’équipe Inserm/Université de la Méditerranée
de Nicolas Lévy1 et Annachiara De Sandre-Giovannoli avec l’équipe de Carlos López-Otín
(Université d’Oviedo)2 a permis de créer un tel modèle. Le traitement des souris par
thérapie génique a permis de rallonger significativement la durée de vie et d'améliorer
plusieurs paramètres chez des souris traitées.
Ces travaux publiés le 26 octobre 2011 dans Science Translational Medicine ont été
soutenus par l’AFM grâce aux dons du Téléthon.
La Progéria est une maladie génétique rare. Les enfants qui en souffrent donnent l’impression
d’un vieillissement accéléré (cheveux rares, douleurs articulaires, peau fine et glabre, problèmes
cardiovasculaires). En 2003, l’origine de la maladie est identifiée par Nicolas Levy et son équipe
qui découvrent l'implication du gène LMNA codant des protéines nucléaires, les lamines A et C.
La mutation entraîne la production d'une protéine raccourcie, la progérine, qui s’accumule dans
les noyaux des cellules, et exerce un effet toxique provoquant leur déformation et différents
dysfonctionnements. Il a depuis été montré que la progérine s’accumule progressivement dans
les cellules normales, établissant un lien entre la maladie et le vieillissement physiologique.
En 2008, un essai clinique européen démarre chez 12 enfants atteints de Progéria. Ce traitement
repose sur une combinaison de deux molécules existantes : les statines (indiquées dans le
traitement et la prévention de l’athérosclérose et des risques cardiovasculaires) et les aminobisphosphonates
(indiquées dans le traitement de l’ostéoporose et dans la prévention des
complications de certains cancers). L’utilisation de ces deux molécules vise à modifier
chimiquement la progérine afin d'en réduire la toxicité. Cependant, si cette thérapie a pour
objectif de ralentir l'évolution de la maladie, elle ne permet pas de réduire les quantités de
progérine. Afin d'étudier cet aspect, il manquait aux chercheurs un modèle animal pertinent.
Un modèle "authentique" de Progeria…
Pour générer un tel modèle, les collaborateurs Espagnols et Français ont pensé à introduire
chez des souris une mutation génétique (G609G) équivalente à celle identifiée chez l’homme
1 Inserm UMR_S 910 "Génétique Médicale et Génomique Fonctionnelle", Université de la
Méditerranée, Faculté de Médecine de Marseille Timone et AP-HM
2 Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Medicina, Instituto
(G608G) afin de reproduire le mécanisme pathologique exact en oeuvre chez les enfants, pour pouvoir le bloquer. Ces souris modèles ont été générées sous la direction de Bernard Malissen par la plateforme IBISA localisée au Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy3. Cette démarche a permis d’obtenir des souriceaux qui produisaient la progérine, caractéristique de la maladie chez l’homme. Les souris mutées présentent à partir de 3 semaines de vie, des défauts de croissance, une perte de poids des déformations osseuses ainsi que des anomalies cardiovasculaires et métaboliques mimant le phénotype humain et réduisant considérablement leur durée de vie (103 jours en moyenne vs 2 ans chez des souris sauvages). La progérine produite s'accumule dans les cellules murines selon un mécanisme génétique (épissage anormal) identique à celui observé chez l'homme, à l'origine des anomalies caractéristiques de la maladie.
…pour une thérapie génique ciblée
Grâce à ce modèle animal unique de Progéria, les chercheurs se sont attelés à la mise en place d'une thérapie ciblée sur la mutation, afin de réduire et si possible d'empêcher la production de la progérine. Pour cela, ils ont utilisé la technologie dite des oligonucléotides antisens « vivo-morpholino ». « Cette technologie, explique Nicolas Levy, est basée sur l’introduction chez les souris malades d’un oligonucléotide antisens synthétique. Cette séquence sert à bloquer, comme dans la progéria, ou au contraire à faciliter la production d’une protéine fonctionnelle par un gène. Dans le cas présent, la production de progérine mais aussi de Lamine A issues du gène, ont été réduites».
Les souris traitées par cette nouvelle technologie ont ainsi vu leur espérance de vie augmenter de façon très significative, passant à 155 jours en moyenne avec un maximum de 190 jours.
L'équipe de Nicolas Lévy, toujours en collaboration avec celle de Carlos López-Otín, a l’intention de traduire ces travaux précliniques dans un nouvel essai thérapeutique à proposer aux enfants, éventuellement en association avec d’autres molécules pharmacologiques. D’autres recherches sont menées en parallèle afin de trouver des voies alternatives d’administration des oligonucléotides antisens.
Pour en savoir plus :
Splicing-Directed Therapy in a New Mouse Model of Human Accelerated Aging
Fernando G. Osorio,1 Claire L. Navarro,2 Juan Cadiñanos,1 Isabel C. López-Mejía,3 Pedro M. Quirós,1 Catherine Bartoli,2 José Rivera,4 Jamal Tazi,3 Gabriela Guzmán,5 Ignacio Varela,1 Danielle Depetris,2 Félix de Carlos,6 Juan Cobo,6 Vicente Andrés,4 Annachiara De Sandre-Giovannoli,2,7 José M. P. Freije,1 Nicolas Lévy,2,7 Carlos López-Otín1†
1Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Medicina, Instituto Universitario de Oncología, Universidad de Oviedo, 33006 Oviedo, Spain. 2Université de la Méditerranée, Inserm UMR_S 910, Faculté de Médecine de Marseille, 13385 Marseille cedex 05, France. 3Institut de Génétique Moléculaire, UMR 5535 CNRS, 34293 Montpellier cedex 5, France. 4Departamento de Epidemiología, Aterotrombosis e Imagen, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, 28029 Madrid, Spain. 5Servicio de Cardiología, Hospital Universitario La Paz, 28046 Madrid, Spain. 6Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas and Instituto Asturiano de Odontología, Universidad de Oviedo, 33006 Oviedo, Spain.7AP-HM, Département de Génétique Médicale, Hôpital d’Enfants de la Timone,
13385 Marseille cedex 05, France.
Science Translational medicine, octobre 2011
Contacts chercheurs :
Nicolas Levy ou Annachiara De Sandre-Giovannoli
[email protected]
Contacts presse :
Inserm - Priscille Rivière
Tel : 01 44 23 60 97 - [email protected]
AFM - Anne-Sophie Midol
Tel : 01 69 47 28 28
[email protected]
Université de la Méditerranée Aix Marseille II II - Delphine Bucquet 06 12 74 62 32
[email protected]
3 La plateforme IBISA du Centre d'Immunologie de Marseille Luminy, vient de donner naissance au Centre d'Immunophénomique de Marseille
Progéria : résultats prometteurs d’une nouvelle thérapie génique chez
l’animal
Depuis quelques années, la recherche scientifique autour de la Progéria, maladie qui
entraine un vieillissement prématuré des enfants, avance à grand pas. En 2003 le gène a
été découvert par l’équipe de Nicolas Lévy et en 2008 douze enfants ont pu entrer dans un
essai clinique combinant deux molécules dans le but de ralentir les effets du
vieillissement précoce caractéristique de la maladie. Toutefois, les chercheurs
poursuivent leurs efforts, pour, cette fois-ci, tenter de corriger les conséquences du
défaut génétique à l’origine de la Progéria. Jusqu’alors aucun modèle mimant exactement
les effets de la maladie chez l’homme n’existait. Les travaux menés en étroite
collaboration depuis plusieurs années par l’équipe Inserm/Université de la Méditerranée
de Nicolas Lévy1 et Annachiara De Sandre-Giovannoli avec l’équipe de Carlos López-Otín
(Université d’Oviedo)2 a permis de créer un tel modèle. Le traitement des souris par
thérapie génique a permis de rallonger significativement la durée de vie et d'améliorer
plusieurs paramètres chez des souris traitées.
Ces travaux publiés le 26 octobre 2011 dans Science Translational Medicine ont été
soutenus par l’AFM grâce aux dons du Téléthon.
La Progéria est une maladie génétique rare. Les enfants qui en souffrent donnent l’impression
d’un vieillissement accéléré (cheveux rares, douleurs articulaires, peau fine et glabre, problèmes
cardiovasculaires). En 2003, l’origine de la maladie est identifiée par Nicolas Levy et son équipe
qui découvrent l'implication du gène LMNA codant des protéines nucléaires, les lamines A et C.
La mutation entraîne la production d'une protéine raccourcie, la progérine, qui s’accumule dans
les noyaux des cellules, et exerce un effet toxique provoquant leur déformation et différents
dysfonctionnements. Il a depuis été montré que la progérine s’accumule progressivement dans
les cellules normales, établissant un lien entre la maladie et le vieillissement physiologique.
En 2008, un essai clinique européen démarre chez 12 enfants atteints de Progéria. Ce traitement
repose sur une combinaison de deux molécules existantes : les statines (indiquées dans le
traitement et la prévention de l’athérosclérose et des risques cardiovasculaires) et les aminobisphosphonates
(indiquées dans le traitement de l’ostéoporose et dans la prévention des
complications de certains cancers). L’utilisation de ces deux molécules vise à modifier
chimiquement la progérine afin d'en réduire la toxicité. Cependant, si cette thérapie a pour
objectif de ralentir l'évolution de la maladie, elle ne permet pas de réduire les quantités de
progérine. Afin d'étudier cet aspect, il manquait aux chercheurs un modèle animal pertinent.
Un modèle "authentique" de Progeria…
Pour générer un tel modèle, les collaborateurs Espagnols et Français ont pensé à introduire
chez des souris une mutation génétique (G609G) équivalente à celle identifiée chez l’homme
1 Inserm UMR_S 910 "Génétique Médicale et Génomique Fonctionnelle", Université de la
Méditerranée, Faculté de Médecine de Marseille Timone et AP-HM
2 Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Medicina, Instituto
(G608G) afin de reproduire le mécanisme pathologique exact en oeuvre chez les enfants, pour pouvoir le bloquer. Ces souris modèles ont été générées sous la direction de Bernard Malissen par la plateforme IBISA localisée au Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy3. Cette démarche a permis d’obtenir des souriceaux qui produisaient la progérine, caractéristique de la maladie chez l’homme. Les souris mutées présentent à partir de 3 semaines de vie, des défauts de croissance, une perte de poids des déformations osseuses ainsi que des anomalies cardiovasculaires et métaboliques mimant le phénotype humain et réduisant considérablement leur durée de vie (103 jours en moyenne vs 2 ans chez des souris sauvages). La progérine produite s'accumule dans les cellules murines selon un mécanisme génétique (épissage anormal) identique à celui observé chez l'homme, à l'origine des anomalies caractéristiques de la maladie.
…pour une thérapie génique ciblée
Grâce à ce modèle animal unique de Progéria, les chercheurs se sont attelés à la mise en place d'une thérapie ciblée sur la mutation, afin de réduire et si possible d'empêcher la production de la progérine. Pour cela, ils ont utilisé la technologie dite des oligonucléotides antisens « vivo-morpholino ». « Cette technologie, explique Nicolas Levy, est basée sur l’introduction chez les souris malades d’un oligonucléotide antisens synthétique. Cette séquence sert à bloquer, comme dans la progéria, ou au contraire à faciliter la production d’une protéine fonctionnelle par un gène. Dans le cas présent, la production de progérine mais aussi de Lamine A issues du gène, ont été réduites».
Les souris traitées par cette nouvelle technologie ont ainsi vu leur espérance de vie augmenter de façon très significative, passant à 155 jours en moyenne avec un maximum de 190 jours.
L'équipe de Nicolas Lévy, toujours en collaboration avec celle de Carlos López-Otín, a l’intention de traduire ces travaux précliniques dans un nouvel essai thérapeutique à proposer aux enfants, éventuellement en association avec d’autres molécules pharmacologiques. D’autres recherches sont menées en parallèle afin de trouver des voies alternatives d’administration des oligonucléotides antisens.
Pour en savoir plus :
Splicing-Directed Therapy in a New Mouse Model of Human Accelerated Aging
Fernando G. Osorio,1 Claire L. Navarro,2 Juan Cadiñanos,1 Isabel C. López-Mejía,3 Pedro M. Quirós,1 Catherine Bartoli,2 José Rivera,4 Jamal Tazi,3 Gabriela Guzmán,5 Ignacio Varela,1 Danielle Depetris,2 Félix de Carlos,6 Juan Cobo,6 Vicente Andrés,4 Annachiara De Sandre-Giovannoli,2,7 José M. P. Freije,1 Nicolas Lévy,2,7 Carlos López-Otín1†
1Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Medicina, Instituto Universitario de Oncología, Universidad de Oviedo, 33006 Oviedo, Spain. 2Université de la Méditerranée, Inserm UMR_S 910, Faculté de Médecine de Marseille, 13385 Marseille cedex 05, France. 3Institut de Génétique Moléculaire, UMR 5535 CNRS, 34293 Montpellier cedex 5, France. 4Departamento de Epidemiología, Aterotrombosis e Imagen, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, 28029 Madrid, Spain. 5Servicio de Cardiología, Hospital Universitario La Paz, 28046 Madrid, Spain. 6Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas and Instituto Asturiano de Odontología, Universidad de Oviedo, 33006 Oviedo, Spain.7AP-HM, Département de Génétique Médicale, Hôpital d’Enfants de la Timone,
13385 Marseille cedex 05, France.
Science Translational medicine, octobre 2011
Contacts chercheurs :
Nicolas Levy ou Annachiara De Sandre-Giovannoli
[email protected]
Contacts presse :
Inserm - Priscille Rivière
Tel : 01 44 23 60 97 - [email protected]
AFM - Anne-Sophie Midol
Tel : 01 69 47 28 28
[email protected]
Université de la Méditerranée Aix Marseille II II - Delphine Bucquet 06 12 74 62 32
[email protected]
3 La plateforme IBISA du Centre d'Immunologie de Marseille Luminy, vient de donner naissance au Centre d'Immunophénomique de Marseille